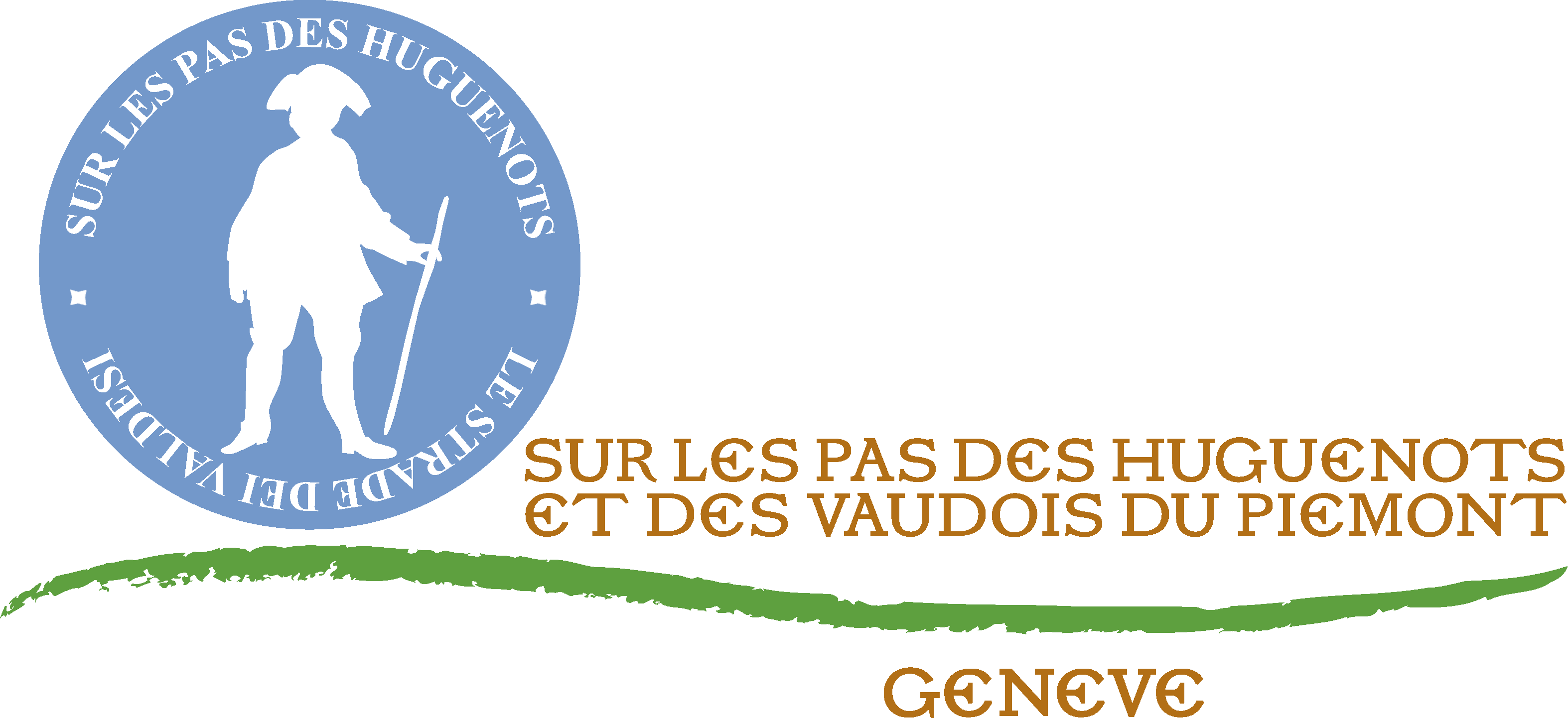1 Plainpalais et Jonction
Pont Wilsdorf / rue de l’Ecole-de-Médecine
Entre Arve et Rhône s’étend au XVIe siècle une vaste plaine marécageuse souvent inondée par les crues : la Jonction devient le Jardin de Genève, grâce à des réfugiés huguenots, cultivateurs du midi de la France. Ils plantent des légumes encore peu connus à Genève : le cardon, devenu AOC genevoise, ou l’artichaut violet. Les rues des Maraîchers, des Plantaporrêts (cultivateurs de poireaux), des Jardins, de la Ferme, de la Puiserande (roue qui puise l’eau) rappellent ce passé. Le duc de Rohan (1574-1638) est à l’origine de la promenade de la Plaine de Plainpalais aménagée en jeu du mail (ancien golf) à la mode à cette époque.

2 Famille de Saussure
Rue Horace Bénédict-de-Saussure
Venant de Lorraine, les de Saussure se réfugient à Lausanne, puis des membres de cette famille huguenote s’établissent à Genève. Plusieurs sont devenus célèbres : Horace-Bénédict (1740-1799) célèbre pour son ascension du Mont-Blanc en 1787 et ses observations scientifiques, Albertine Necker de Saussure (1766-1841), auteure de l’Éducation progressive (primé par l’Académie française), qui influence durablement la pédagogie et les principes de l’éducation des femmes qu’elle prône identique à celle des hommes, et Ferdinand (1857-1913), dont le cours de linguistique générale est à l’origine de toute la linguistique du XXe siècle.

Bibliothèque de Genève (BGE)
3 Musée Rath
Place de Neuve
Premier musée des beaux-arts ouvert au public, le Musée Rath est édifié en 1826 grâce à la générosité des soeurs Rath, issues d’une famille huguenote arrivée de Nîmes en 1666 lors du Grand Refuge et héritières de la fortune de leur frère, lieutenant du tsar.
L’une des deux, Jeanne-Henriette (1773-1856), est peintre de portraits de petit format, miniaturiste sur vélin, ivoire et émail, copiste et fait fortune dans son activité artistique. Elle propose à la Société des arts de Genève d’animer l’Académie des jeunes filles, école de dessin unique en Europe, et devient membre associée honoraire de la Société des arts en 1801.

4 Mur des Réformateurs
Parc des Bastions
Ce monument, construit entre 1909 et 1917, commémore les 400 ans de la naissance de Calvin et les 350 ans de la fondation de l’Académie avec des statues de 5 mètres de haut des 4 Réformateurs de Genève : Guillaume Farel (1489-1565), Jean Calvin (1509-1564), John Knox (1513-1572) et Théodore de Bèze (1513-1605) et la devise de Genève adoptée à la Réforme : Post Tenebras Lux (Après les Ténèbres la Lumière). 6 statues d’hommes d’Etat représentent les lieux de diffusion de la Réforme calviniste et 8 bas-reliefs des évènements de celle-ci. 2 blocs mentionnent Luther et Zwingli, grands réformateurs et Marie Dentière, théologienne de la Réforme.

5 Université
Parc des Bastions
Pour Calvin, un enseignement de qualité doit servir la nouvelle foi. En 1559 les Leges Academiae Genevensis créent un collège et une académie, où sont enseignés la théologie, le grec, l’hébreu et l’essentiel du savoir scientifique et philosophique. Au début, les cours sont regroupés dans l’ancien couvent de Rive. Puis le collège s’installe près de Saint-Antoine et l’Académie se déplace à l’Eglise Notre-Dame-la-Neuve, aujourd’hui l’Auditoire. Calvin et Bèze y enseignent et l’Académie prend une dimension internationale en attirant des étudiants de toute l’Europe. En 1873, elle devient Université et déménage dans le bâtiment des Bastions.

6 Palais Eynard et Palais de l’Athénée
Rue de la Croix-Rouge 4 et Rue de l’Athénée 2
Jean-Gabriel (1775-1863) et Anna (1793-1868) Eynard-Lullin sont les bâtisseurs des 2 palais. Lui descend d’une famille huguenote du Dauphiné réfugiée à Genève à la fin du XVIIème siècle. Dans le style des palazzi italiens, la construction de la résidence des Eynard aux Bastions débute en 1817. Des années plus tard, mais à proximité du premier, le couple fait construire le Palais de l’Athénée pour l’offrir à la Société des Arts. Encore en chantier, ce palais accueille en octobre 1863 la Conférence constitutive de la Croix-Rouge internationale.

7 Cathédrale Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre
Une communauté chrétienne a peut-être existé dès la fin du IIe siècle à Genève qui devient chef-lieu d’un diocèse. Sur la colline se dressent une 1ère cathédrale et un baptistère, rejoints vers 400 par une 2e cathédrale. Les 2 sont rassemblées autour de l’an 1000. Entre 1160 et 1230 la cathédrale gothique Saint-Pierre-aux-liens est construite. En août 1535 la messe est suspendue à Genève et la population se livre à des destructions iconoclastes, bientôt interdites. A l’adoption officielle de la Réforme en mai 1536, la cathédrale est aménagée en temple protestant, mais le nom de cathédrale perdurera.

8 Maison Mallet
Cour Saint-Pierre 10
En 1721, Gédéon Mallet (1666-1750), marchand et banquier descendant d’un marchand-drapier huguenot de Rouen réfugié à Genève au XVIe siècle, achète à la ville le terrain symbolique de l’ancien cloître de la Cathédrale où les Genevois avaient adopté la Réforme le 21 mai 1536. Les Lois somptuaires de la Réforme exigeant modestie ont été assouplies pour les bâtiments qui ornent la ville. La hauteur des pièces, les boiseries et parquets de cet hôtel particulier à la mode parisienne sont négociées et celui-ci offre tout le confort de l’époque.
Le Musée international de la Réforme est installé à la maison Mallet.

9 Agrippa d’Aubigné
Terrasse Agrippa-d’Aubigné
Enfant, Agrippa d’Aubigné (1552-1630) est déjà capable de lire l’hébreu, le grec, le latin et le français ! À 13 ans, il vient à Genève suivre les cours du collège puis retourne en France où il s’engage dans la défense des Huguenots au côté d’Henri de Navarre, futur Henri IV roi de France. Il soutient également les Huguenots en en rédigeant l’Histoire universelle depuis 1550 jusqu’en 1601, ouvrage rapidement condamné et Les Tragiques, récit des guerres de religion écrit en vers. Condamné à mort en France, d’Aubigné se réfugie à Genève en 1620, acquiert le Château du Crest (Jussy) et collabore à la restauration des fortifications de Genève.

10 Josué Janavel
Rue de la Madeleine 13, anciennement Auberge du Flacon
Fervent défenseur de la foi protestante des Vaudois du Piémont et chef de la résistance armée au duc de Savoie qui les persécute, Josué Janavel est banni de Savoie et devient de 1664 à 1690 gérant de l’Auberge du Flacon. Depuis là, il organise l’accueil des réfugiés vaudois et les actions de guérilla au pays.
Les chemins d’exil des Huguenots fuyant la France et des Vaudois du Piémont déportés sous escorte du duché de Savoie se rejoignent à Genève. Ils sont persécutés à la même période pour leur foi et sont tous en route vers l’Europe du Nord.

11 Antoine Froment et Marie Dentière
Place du Molard
Le 1er janvier 1533 au Molard, Antoine Froment (1508?-1581), de Mens en Dauphiné, proclame les idées nouvelles de la Réforme. C’est une première sur la voie publique ! Froment apprend à lire et à écrire à tous et toutes, ce qui ne plaît pas aux magistrats genevois. Avec son épouse Marie Dentière, ils partent dans le Chablais et y ouvrent un pensionnat pour filles avec enseignement du grec et du latin avant de revenir à Genève. En 1559, le Collège et l’Académie créés par Calvin n’accueilleront que des garçons. Marie Dentière, très érudite, publie des écrits théologiques, ce qui déplaît profondément aux Réformateurs.

12 Temple de la Fusterie
Place de la Fusterie
Avec la Réforme, la présence aux cultes est obligatoire. Et les réfugiés affluent, après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. L’urgence de construire un nouveau lieu de culte pour désengorger les temples existants est évidente dès 1697. Le temple Neuf est bâti en 1714 par Jean Vennes, architecte huguenot du Languedoc et des ouvriers bâtisseurs : maçons, charpentiers, menuisiers, serruriers, etc. en majorité réfugiés. Il prend le nom de la Fusterie, comme la place qui avait remplacé en 1487 le port où arrivaient les grandes pièces de bois appelées fustes. Le temple devient hôpital militaire en 1814, puis en 1871.

13 Escalade et Mère Royaume
Rue de la Monnaie
Catherine et Pierre Royaume, graveur de la Monnaie de Genève, ont fui les massacres de la Saint-Barthélemy à Lyon. Ils habitent au-dessus de la Porte de la Monnaie. Une nuit sans lune de décembre 1602, l’armée du duc de Savoie attaque la Genève réformée, libre et indépendante, et commence l’escalade des remparts. Mais un gardien divin veille.
Réveillés en sursaut, les citoyens se
précipitent pour défendre leur ville et remportent la victoire. La Mère Royaume aurait contribué à défendre la cité en jetant de sa fenêtre un pot de soupe sur les ennemis. Le 12 décembre, des marmites en chocolat sont brisées pour rappeler cette victoire.

14 Temple et quartier de Saint-Gervais
Rue des Terreaux-du temple 12
Simon Goulart (1543-1628) réfugié huguenot et pasteur à Saint-Gervais s’occupe de théologie, philosophie, astrologie, alchimie, démonologie et musique. Ses écrits montrent un calvinisme moins austère.
Les horlogers huguenots s’installent dans le quartier. Simultanément, les Lois somptuaires de la Réforme imposent des arts moins ostentatoires que l’orfèvrerie du XVe siècle. La Fabrique commence alors à s’organiser en une stricte division du travail regroupant graveurs, ciseleurs, guillocheurs, monteurs de boîtes ou émailleurs, qui travaillent en ateliers pour les marchands qui fournissent argent et matières premières.